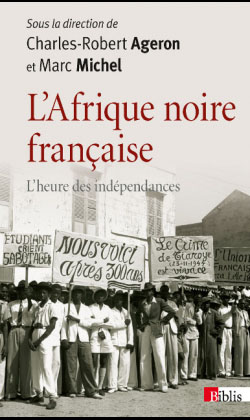
L’Afrique noire française : l’heure des Indépendances/Rapport général
L’Afrique noire française : l’heure des Indépendances
Charles-Rober Ageron & Marc Michel, éds.
Actes du colloque « La France et les indépendances des pays d’Afrique noire et de Madagascar »
organisé par l’Institut d’histoire des pays d’outre-mer et l’Institut d’histoire du temps présent.
Aix-en-Provence : 26-29 avril 1990
Avec le concours du Ministère de la Coopération et du Développement.
CNRS Editions. Paris. 1992. 729 p.
Rapport général
Dans leur marche à l’indépendance, les pays d’Afrique noire et de Madagascar ont connu une évolution liée à des facteurs multiples, opérant sur le double plan des colonies et de la métropole et également influencés par l’environnement international.
La première séance de ce colloque international dont j’ai l’honneur d’être le rapporteur a pour thème le rôle des forces intérieures; cette préséance n’est ni arbitraire ni protocolaire; elle est le résultat de la primauté, reconnue par l’historiographie, du facteur interne, de réaction au sein des mouvements politiques, associatifs, socioprofessionnels ou de leaders autochtones, etc., dans la marche à l’indépendance. L’importance du thème se mesure au demeurant par le nombre de communications s’y rapportant (onze au total), par leur diversité et par leur richesse.
Incontestablement, les partis politiques, créés au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, ont constitué un cadre privilégié du débat politique sur la question coloniale et sur les aspirations à l’indépendance; trois communications traitent de cette question.
Se situant dans le contexte de l’AOF de 1957 à 1960, Joseph-Roger de Benoist évoque l’évolution des partis fédéraux (RDA, PRA, PFA). Le RDA était de loin le plus puissant et le mieux structuré, et son évolution fut marquée par le divorce d’avec le PCF en 1950 et par l’amorce d’un processus de collaboration avec le gouvernement français. Le Ille congrès du mouvement, longtemps différé, eut lieu en 1957 à Bamako où le problème du fédéralisme faillit provoquer la rupture. Joseph-Roger de Benoist s’appuyant sur de longues citations de Félix Houphouët-Boigny sur le thème d’une « communauté d’hommes différents, mais égaux en droits et en devoirs» éclaire l’option du RDA pour une Communauté franco-africaine. Mais une fédération réelle égalitaire était-elle possible? C’est le grand dilemme que l’auteur évoque à travers les déclarations d’Houphouët-Boigny, des textes de Gabriel Lisette et le scepticisme de Léopold Sedar Senghor qui perçut le danger de la « communauté du pot de fer [la France] et du pot de terre [les États squelettiques] » et dénonça toute politique de balkanisation de la Fédération. C’est ainsi que Senghor lança un appel « à la fusion des partis africains en un grand parti unifié qui, s’inspirant du socialisme, maintienne l’autonomie de la pensée africaine ». Ce courant donna naissance, en janvier 1957, à Dakar, à la Convention africaine. La même année, un troisième mouvement lié à la SFIO fut créé à Conakry; c’est le MSA (Mouvement socialiste africain) qui se manifesta par une opposition à un parti unique quel qu’il soit et se donna pour objectif de « réaliser en Afrique noire une démocratie assutant à chaque individu une indépendance complète et le plein épanouissement de sa personnalité ». Quant au PRA, il naîtra de la pression de l’aile radicale (Bertin Borna, Abdoulaye Ly, Amadou Mahtar Mbow, etc.) qui adopte sans ambiguïté le mot d’ordre d’indépendance. D’indépendance, il était question dans le milieu des hauts fonctionnaires français, car, au lendemain de l’indépendance du Ghana, le haut commissaire Gaston Cousin déclarait que l’éventualité de l’indépendance des territoires d’outre-mer devait être regardée en face.
Le référendum de 1958 apparaît comme un coup dur pour le courant fédéraliste, car les partis interterritoriaux prirent des positions variées, ce qui aboutit, souligne R. de Benoist, à des « oui» aux sens différents et aux cas particuliers du RDA de Guinée et du PRA du Niger qui optèrent pour le « non ».
La sensibilité extrême du danger de la balkanisation détermine Senghor, président du groupe interparlementaire du PRA et Doudou Gueye, secrétaire général de la section sénégalaise du RDA, à créer en juillet 1959 le PFA dont le mot d’ordre était « unité africaine avant l’indépendance ». Ce sursaut n’évita pas le processus d’une marche à l’indépendance en ordre dispersé. En l’espace de quelques mois, toute l’AOF accédait à la souveraineté sans effusion de sang, souligne J.R. de Benoist, mais j’ajoute dans le cadre de microÉtats dont certains, de surcroît, sont victimes de l’enclavement; trente ans apr:ès, tous sont frappés par une crise rampante qui remet à l’ordre du jour les vertus de la complémentarité et de l’Union.
Jean Suret-Canale a choisi le cas de la Guinée pour étudier le rôle des forces intérieures dans la marche à l’indépendance. Il s’agit, en fait, de l’émergence du PDG-RDA et de la montée du pouvoir africain », sous la direction de Sékou Touré. L’auteur évoque tout d’abord le poids de l’autorité coloniale, face à l’indigène astreint au travail forcé, à la justice administrative et à l’humiliation. La première Constituante — 1945-1946 — avait certes ouvert une brèche dans le système, mais les réformes étaient restées formelles et inachevées, surtout avec le maintien du double collège assurant une représentation disproportionnée aux Européens. C’est dans ce contexte de frustration que naît le PDG, section guinéenne du RDA ; il est le résultat de la fusion d’éléments issus du Groupe d’études communistes, du Parti progressiste de Guinée et de divers groupements ethniques. Après une phase d’essor relatif, le PDG connaît, à partir de 1948, une décadence due à la répression, aux 12 mutations de fonctionnaires jugés turbulents, aux poursuites judiciaires, dans une atmosphère d’intimidation policière qui atteint son paroxysme en 1950. Face à la répression, le RDA résiste et s’organise; la publication du journal Coup de bambou, sous la direction de Ray-Autra, permet de diffuser les mots d’ordre et les orientations du parti. Un tournant important est la longue grève de 72 jours pour le réajustement des salaires, qui fut réprimée par des licenciements massifs et l’incarcération des leaders. Le RDA, cette fois non plus, ne plie pas; il lance, à travers tout le pays, une campagne qui lui vaut un sursaut aux élections de 1951. Le « désapparentement » du RDA est entériné par le PDG, mais comme mesure tactique; l’action anticolonialiste se poursuit avec pour principaux axes la revendication syndicale et la lutte contre la chefferie. J. Suret-Canale met en exergue le problème de la chefferie traditionnelle en particulier au Fouta-Djalon. Pour lui, les manifestations de violence populaire qui vont apparaître à partir de 1954 sont la conséquence de la terreur permanente exercée par la chefferie, avec la « caution de l’autorité française ». Le scrutin du 27 juin 1954 qui oppose Sékou Touré à Barry Diawadou, fils de l’Almamy de Dabola, est analysé à travers ce prisme, la victoire de Barry Diawadou résultant de manipulations suivies de protestations et de manifestations après la proclamation des résultats. La tension qui prévaut est le prélude à la « montée du pouvoir africain ». Le PDG s’affirme par la volonté punitive contre la chefferie et les hommes des partis administratifs, situation qui dégénère en violence; habitations détruites ou incendiées, manifestations diverses contre les militants du BAG (Bloc africain de Guinée). La tension politique et sociale atteint son paroxysme avec l’affaire de Tondon en février 1955. Il se crée un phénomène de polarisation des contradictions autour du président de la sous-section RDA et du chef traditionnel; au cours d’une démonstration de militantes RDA, le chef traditiionnel, conspué, frappe du sabre; une militante meurt dans des conditions tragiques; elle deviendra l’héroïne du PDG.
Aux élections législatives de janvier 1956, le PDG remporte une large majorité. Le Fouta-Djalon, longtemps hostile, bascule; la conséquence immédiate fut la ruine de la chefferie traditionnelle. La mise en vigueur de la loi-cadre et du conseil de gouvernement consacre la suprématie du PDG, qui s’assure le contrôle de l’ensemble de la société; au moment du référendum, note J. Suret-Canale, l’administration n’avait donc aucun moyen de s’opposer au vote du « non », comme ce fut le cas au Niger et en Somalie. Nous conclurons la présentation de cette communication en ajoutant, en tant que témoin, que les immenses espoirs nés de l’indépendance de la Guinée allaient très tôt s’estomper : les modes de gestion de l’Etat et d’embrigadement de la société civile, inspirés du stalinisme, permirent à Sékou Touré d’imposer une dictature sanglante ; curieusement, la même structure, à des degrés divers, allait être reproduite dans la quasi-totalité des États de l’Afrique francophone, avec l’instauration de fait du parti unique.
Les partis politiques et les syndicats d’Afrique noire ont eu des rapports plus ou moins étroits et durables avec les formations métropolitaines ; l’apparentement du RDA au groupe du PCF au nom de l’ « alliance fondamentale du prolétariat et des peuples dépendants » est connue. Danièle Domergue-Cloarec tente de nous éclairer, dans sa communication, sur le soutien de l’UDSR et de la SFIO aux partis politiques d’Afrique occidentale. Il se dégage de la lecture de l’article le souci d’établir un parallèle sur le double plan des principes et de la pratique politiques. Pour la SFIO, l’auteur remonte au congrès de 1948 qui, tout en saluant l’aspiration des peuples d’outre-mer dans la réalisation de leur indépendance, précise que seule une structure englobant la participation de l’Afrique à l’édification de l’Europe peut sauvegarder leurs droits. Quant à l’UDSR (Union démocratique et socialiste de la Résistance), dès sa fondation, elle possède, estime l’auteur, du fait d’une large expérience politique de ses leaders, une vision plus progressiste des problèmes d’outre-mer; bénéficiant du rôle joué par François Mitterrand dans le désapparentement du RDA, le mouvement laissait une grande liberté de manoeuvre aux leaders africains. Danièle Domergue-Cloarec situe le problème dans le contexte de l’édification de la CECA où seule la métropole figurait. Lorsqu’en 1959 se posa le problème de l’intégration des territoires d’outre-mer, la SFIO se montra hésitante, alors que l’UDSR de F. Mitterrand voulut faire de l’Afrique son point d’ancrage, estimant que la France avait des obligations envers ce continent. D. Domergue-Cloarec identifie en la personne de Gabriel Lisette le relais principal de cette politique. Analysant les problèmes des fédérations africaines, elle tente d’identifier les erreurs des élus et des partis, évoquant en particulier les déboires de Lamine Gueye qui, en 1955, s’était hasardé à mener campagne en Casamance, et les succès grandissants de Senghor. Avec la loi-cadre, les partis politiques français semblent désorientés par l’accélération des événements et la polarisation exercée par la situation en Algérie. Cette situation aurait déterminé la création d’un groupe d’étude: le Rassemblement démocratique pour la communauté franco-africaine. Après 1957, l’UDSR se prononce pour une union fédérale. Au congrès d’Issy-les-Moulineaux de septembre 1958, les socialistes se garderont également de prononcer le mot d’indépendance. De tout cela, D. Domergue-Cloarec conclut que les partis politiques français étaient davantage intéressés à leurs fédérations d’outremer au moment des élections, l’USDR ayant cependant manifesté une plus grande sensibilité aux problèmes africains.
Alors que l’activité des partis politiques a retenu l’attention de nombreux chercheuts, le rôle des associations a été longtemps négligé. Les contributions d’Odile Goerg, de Thierno Bah et d’Hélène d’Almeida-Topor tentent de combler cette lacune.
Odile Goerg s’est penchée sur le mouvement associatif et sur le processus des indépendances en AO F. Il est certain que la promulgation en 1946 de la loi sur les associations suscita la multiplication des groupements qui participèrent de l’ambiance générale qui a rythmé la marche à l’indépendance. L’auteur s’engage, dans un premier temps, à des réflexions méthodologiques et propose une typologie. Les vérifications effectuées dans les archives ont permis de dégager un bilan quantitatif estimé fiable et l’établissement de graphiques pour la période 1947-1958-1960 ; ce qui permet des comparaisons éloquentes entre les territoires du Dahomey, du Soudan, du Sénégal, de la Guinée et de la Côte-d’Ivoire. Il s’agit à l’analyse d’une minorité agissante qu’il est facile d’appréhender sur la base des buts avoués (loisirs – solidarités – formation et réflexion) sans pour autant occulter les mutations internes liées au contexte politique. C’est ainsi que diverses associations vont s’investir dans la lutte pour l’émancipation car, dès les années 30, note O. Goerg, il est question de « progrès, de développement économique, social et culturel, d’évolution » avec parfois des préoccupations panafricaines. Dans la plupart des territoires d’AOF, le mouvement associatif cherche à contribuer à l’éveil de la population dans l’optique de la décolonisation. Pour illustrer et préciser son propos, l’auteur examine le cas de la Guinée de 1955 à 1958. Sous l’impulsion du PDG (section locale du RDA), on assiste au dynamisme des associations et à leur radicalisation: c’est ainsi que la seule année 1956, marquée par une grande effervescence politique, voit la création de 53 associations. Dès lors, les jeunes (au sens large du terme) s’affirment comme l’avant-garde du mouvement de contestation marqué par la virulence des propos dans la dénonciation de l’arbitraire colonial. O. Goerg s’est également penchée sur les éléments scolarisés, groupés au sein de l’Union générale des élèves et des étudiants de Guinée qui, dès 1957, prend une position claire en faveur de l’indépendance, tout en réaffirmant son refus d’inféodation à un mouvement politique, en l’occurrence le PDG-RDA. La conclusion d’Odile Goerg est tout à fait pertinente: « C’est donc par dizaines que des associations furent créées au cours des années 50. Elles s’engagent dans un processus dynamique de prise de conscience, d’ouverture et apportèrent leur contribution à la lutte pour l’émancipation. Mais après les indépendances, elles ne purent s’épanouir, du fait de la mise en place de la structure du parti unique qui mettait fin à toutes les activités autrefois autonomes. »
L’histoire des mouvements étudiants africains est un thème vaste et passionnant ; aussi Thierno Bah a-t-il voulu évoquer leur rôle dans la marche à l’indépendance; en s’intéressant à l’expérience de la « première génération » 1948-1956, il a, sans sacrifier la relation des faits, mis l’accent sur les tendances, les idéologies, les formes d’expression, les alliances et l’impact des étudiants sur la société. Les étudiants africains de France et de Dakar, qui font l’objet de cette étude, constituent une minorité active, qui se donne pour vocation d’éclairer la masse et qui s’implique dans la lutte pour l’indépendance. L’année 1951 constitue un tournant, avec l’élection de Cheikh Anta Diop au poste de secrétaire général des étudiants RDA ; il allait jouer un rôle important dans l’engagement politique et dans la radicalisation du mouvement étudiant. Cette tendance aboutit à la naissance en 1951 de la FEANF (Fédération des étudiants d’Afrique noire en France) qui joua un rôle d’avant-garde dans la marche à l’indépendance. Une question importante que T. Bah a voulu élucider est l’influence des théories marxistes sur le mouvement étudiant africain. Si les rapports officiels sont caractérisés par un amalgame où tous les éléments nationalistes étaient taxés de « cryptocommunistes », il est certain que très peu d’étudiants africains adhèrent au PCF, en dépit de contacts fréquents sur la base d’une alliance tactique. En dehors de la FEANF et des éléments radicaux, d’autres sensibilités ont également marqué le mouvement. Ce fut le cas de l’Union des étudiants catholiques africains qui « au sein de l’Église et à partir du message du Christ, cherchèrent les armes pour la campagne vigoureuse contre le colonialisme ». Ce fut également le cas de l’Amicale des musulmans d’Afrique noire en France qui, dès 1954, fit du bar-restaurant la Kasbah le rendez-vous des éléments nationalistes. Une étude, basée sur des biographies de leaders et de militants aurait pu être stimulante; l’auteur, dans le cadre limité de cette étude, s’est contenté d’évoquer quelques jeunes filles qui, dès cette époque, s’impliquèrent dans le militantisme étudiant; le cas de Solange Faladé, étudiante en médecine, originaire du Dahomey, élue première présidente de la FEANF, aura retenu l’attention, de même que Madeleine Azang, militante active de l’Union des étudiants camerounais. Dans leurs prises de positions, les étudiants africains optèrent sans ambiguïté pour l’indépendance, d’où un divorce précoce avec les élus aux assemblées françaises qui louvoyaient. Le « désapparentement » fut considéré par les éléments radicaux non comme un « recul tactique » mais comme un abandon définitif de la ligne anticolonialiste ; les étudiants rejetèrent également la plate-forme de l’Union française défendue par les élus et accusèrent ces derniers de cautionner l’envoi en Algérie de bataillons de Tirailleurs sénégalais.
Pour diffuser leurs mots d’ordre, pour informer et orienter, les étudiants africains ont édité une presse riche et variée: dès 1952, la Voix de l’Afrique, dirigée par Cheikh Anta Diop; à partir de 1954, l’Étudiant d’Afrique noire, organe de la FEANF dont l’un des rédacteurs fut Albert Tevoedjre qui, dans un éditorial de 1956, exprimait la volonté de « susciter une Afrique nouvelle, libérée de l’agenouillement, de la violence, du gaspillage, enrichie des principales acquisitions du monde moderne, rendue enfin à son sens de la communauté [ … ], à tout son patrimoine spirituel ». Au nombre de ces journaux, on peut citer également Tam- Tam, organe d’expression des étudiants catholiques, et Kaso « vérité » en langue duala) , proche de l’Union des populations du Cameroun (UPC) et dirigé par François Sengat Kuo. A Paris, les formes d’agitations les plus spectaculaires ont été les marches et les meetings. Une marche mémorable est celle du l or mai 1952 à laquelle participèrent tous les ténors des mouvements étudiants et nationalistes: tels Cheikh Anta Diop, Edouard Sankalé, Abdou Moumouni et l’avocat Kaldor dirigeant du Comité de défense des libertés démocratiques.
Les comités anticolonialistes étaient actifs, mais se heurtaient parfois à des groupuscules d’extrême droite qui, en mars 1955, s’attaquèrent à coup de grenades lacrymogènes à un meeting anticolonialiste.
Toutes les occasions devaient être exploitées pour véhiculer le discours anticolonialiste. Lorsqu’ils n’en étaient par les initiateurs, les éléments radicaux avaient l’art de transformer en forums politiques les conférences organisées dans « leur territoire» : c’est ainsi qu’ils transformèrent ‘ en meeting anticolonialiste une conférence de Senghor sur le thème du fédéralisme, en 1955, à la cité universitaire de Paris. En Afrique même, les étudiants ont exercé une influence réelle sur la société. A Dakar, ils se groupèrent en associations (AED et plus tard UGEAO) et s’engagèrent dans l’agitation anticolonialiste. Entre Paris, Dakar et d’autres centres en Afrique, s’établit une coordination du mouvement. Sur place, les étudiants trouvèrent un relais approprié dans les organisations de jeunes (RJRDA – Rassemblement de la jeunesse démocratique africaine) et auprès des élèves des lycées. Sur le plan international, les étudiants d’Afrique noire tentèrent de briser les clivages hérités de la colonisation; des contacts existaient avec la WASU basée à Londres et avec l’Association des étudiants coloniaux du Portugal. Ils s’impliquèrent dans l’action de la FMJD et de l’UIE. Cette dernière créa un « bureau colonial» et accorda des bourses d’études aux éléments les plus radicaux. L’administration coloniale tenta de contrer cette ligne dure par le biais de la WAY (World Assembly of Youth) dont le siège est à New York, et du Conseil de la jeunesse de l’Union française. L’expérience ne fut nullement concluante. La consécration de l’activité des étudiants d’Afrique noire sur le plan international fut la participation de deux délégués de la FEANF (Benoit Balla du Cameroun et Diallo Ogo Kane du Sénégal) à la fameuse conférence de Bandoeng en 1955. En conclusion, Thierno Bah a posé le problème de la continuité historique du mouvement étudiant et de ses rapports avec l’État postcolonial; il apparaît qu’une tradition d’agitation et d’engagement s’est maintenue et, hier çomme aujourd’hui, les étudiants africains, par-delà les questions corporatistes, s’impliquent dans les débats de politique générale. La nécessaire prise en compte de leurs aspirations contribuera à transformer l’Afrique en une vraie démocratie où, comme le soulignait en 1952 Ouezzin Coulibaly, « la justice ne sera pas à sens unique et la liberté dans des sarcophages sculptés ».
L’historiographie a privilégié le rôle des élites intellectuelles et politiques dans la marche à l’indépendance; celle-ci n’aurait pas été possible sans les profondes mutations sociopolitiques que l’Afrique a connues au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. C’est sans doute ce qui a déterminé Hélène d’Almeida-Topor à se pencher sur l’aspect économique du mouvement associatif. La question fondamentale est de savoir si la coopération était la solution pour une émancipation économique, dans cette période où l’autonomie préfigurait l’indépendance politique. Pour beaucoup de leaders, l’idée d’une production effectuée dans un cadre associatif semblait adaptée à l’esprit communautaire africain : Mamadou Dia écrit que la coopération situe plus en profondeur dans le domaine de la liberté que toute autre forme de lutte émancipatrice et Sékou Touré posa une question écrite au ministre de la France d’outre-mer pour une mise en application rapide du statut de la coopération agricole. Cette structure apparaît intimement liée à la décolonisation. Dès 1946, les élus africains avaient engagé la lutte contre les Sociétés indigènes de prévoyance qui, par le recrutement obligatoire, symbolisaient l’arbitraire colonial. Les formes nouvelles de coopératives furent mises en place en 1958.… .
Hélène d’Almeida Topor relève dans son étude leurs spécificités en AOF. Nous voyons tout d’abord qu’il s’agit d’un mouvement encadré, la réglementation maintenant la tutelle administrative et l’obligation d’une immatriculation sur un registre; les données chiffrées pour la période 1955-1960 donnent l’impression d’un mouvement dynamique, principalement en Guinée où l’idée coopérative est la plus répandue. Ce dynamisme, remarque H. d’Almeida-Topor, reste cependant limité au secteur primaire, plus de 86 % en 1950-1960 au Sénégal concernant le secteur agricole; un grand handicap est lié à la faiblesse des moyens financiers, à l’exception de certains secteurs privilégiés comme les coopératives artisanales de pêche: celle de Boffa en Guinée a un capital de 500.000 F. Le problème de l’encadrement technique s’est très tôt posé et il fut résolu par la formation de coopérateurs avec l’aide de la métropole. En définitive, conclut H. d’Almeida Topor, le mouvement coopératif ne put constituer une solution pour l’indépendance économique, le contexte économique général n’ayant pas été modifié. Le revenu des adhérents continua à dépendre plus des cours mondiaux que du mode de production locale. Le débat sur la modernisation, qui privilégia l’industrialisation au lendemain de l’indépendance, ne songea pas à une organisation coopérative rationnelle. Nous ajouterons que cette double orientation accentuée par une dépréciation sans précédent des cours des produits de base apparaît comme l’une des causes du naufrage de l’Mrique noire aujourd’hui.
Les considérations qui précèdent montrent à l’évidence qu’une minorité instruite et ouverte à la modernité a joué le rôle décisif dans la marche à l’indépendance. C’est cette élite qui fait l’objet des contributions de G. Wesley Johnson et de Catherine Coquery-Vidrovitch.
G.W. Johnson étudie le thème des élites au Sénégal dans la marche à l’indépendance. Ce territoire, vieille colonie française, a connu la création précoce d’une élite qui profita de l’application des doctrines assimilationnistes. L’auteur commence par examiner les modèles d’assimilation avant la guerre et situe la genèse de ce qui sera le leitmotiv de sa communication: l’ambiguïté. C’est surtout dans les Quatre communes (Saint-Louis, Gorée, Rufisque, Dakar) où les Mricains étaient citoyens français depuis la loi Blaise Diagne de 1915 que l’assimilation était inévitable; c’était l’aspiration de l’élite, et Lamine Gueye, auréolé d’une formation universitaire, constitue pour G.W. Johnson, le prototype de l’assimilé, par opposition à des hommes comme Kwame N’krumah et Nnamdi Azikiwe immergés dans la rigidité « Jim Crow » des préjugés raciaux des États-Unis. Le parallèle permet à l’auteur de situer la différence cruciale: la possibilité au Sénégal d’élire un député au Parlement français, ce qu’aucune autre puissance coloniale n’a envisagé. Blaise Diagne allait donc inaugurer un modèle qui devait être relayé par des personnalités aussi diverses que Houphouët-Boigny et Apithy. Poussant encore plus loin son analyse du phénomène assimilation/ambiguïté, G.W. Johnson évoque l’émergence de ce qu’il dénomme « personnalité schizophrène » chez de nombreux leaders africains francophones ; le terme, souligne l’auteur, n’ayant pas une connotation clinique, mais signifiant la présence d’éléments ou de qualités mutuellement contradictoires ou antagoniques. Blaise Diagne, Galandou Diouf, Senghor et parfois Houphouët- Boigny et Sékou Touré participent de cette personnalité. Le cas de Galandou Diouf est symptomatique du phénomène d’assimilation: ce provincial, qui avait à peine côtoyé les Français, une fois élu député, va présenter l’image parfaite de l’assimilé, se vantant de son éducation chez les religieux, bien que musulman.
Après la Seconde Guerre mondiale, G.W. Johnson perçoit une continuité de l’ambiguïté dans le groupe dirigeant au Sénégal. Pour cela, il évoque, non sans quelque ironie, la conférence de Bamako de 1946, dont les participants voulaient se réunir « pour planifier l’avenir de l’Afrique sur les rives du Niger plutôt que sur celles de la Seine », conférence à laquelle Lamine Gueye et Senghor n’ont pas assisté. Pour l’auteur, les députés africains portèrent leurs masques français pendant de trop longues périodes et se préoccupèrent outre mesure de politique et de culture métropolitaines. Dans cette perspective, l’expérience de Présence africaine dirigée par Alioune Diop et basée à Paris apparaît certes intéressante à l’auteur, mais est considérée également comme un facteur d’enfoncement de l’élite dans l’ambiguïté. Quelques personnalités citées par G.W. Johnson ne se trouvaient pas enlisées dans ce dilemme: il s’agit de Abdoulaye Ly, héritier de la tradition de résistance animée dans les années 20 par Télémaque Sow, et de Cheikh Anta Diop, qui s’efforçait de prouver l’unité culturelle et les accomplissemen ts de l’ Mrique noire « héritière de la civilisation égypto-pharaonique ». La flexibilité et le compromis, nécess,aires dans le contexte de la IVe République, permirent aux éléments assimilés de l’emporter sur les idéologues contestataires. Il reviendra à Senghor, agrégé de l’université, de mettre en place les structures du nouvel État sénégalais; il fera preuve de pragmatisme; il gagna l’alliance du khalife des Mourides, bien qu’étant catholique; il attira des jeunes technocrates et des éléments métis qui, depuis deux siècles, occupaient une position importante dans la vie politique du Sénégal. Tout cela apparaît pour G.W. Johnson comme une « coalition étrange dans un climat politique ambigu ». Mais, estime l’auteur en conclusion, les Sénégalais, bien qu’ayant fait preuve de zèle et d’affection pour la culture française, n’en restèrent pas moins africains dans leur attachement aux valeurs traditionnelles.
La communication de Catherine Coquery-Vidrovitch étudie le rôle des milieux urbains à travers l’action des élus municipaux qui constituent l’élite locale. Alors que G.W. Johnson a été intéressé par l’assimilation caractéristique des fameuses quatre communes du Sénégal, C. Coquery-Vidrovitch a choisi d’examiner le phénomène né de la loi-cadre de 1956. Les élus communaux récemment désignés allaient transformer leurs conseils en véritables arènes politiques. Un aspect important est le statut municipal; jusqu’en 1955, souligne l’auteur, la plupart des communes urbaines étaient des communes indigènes soumises à l’autorité coloniale. Mais le problème devint préoccupant à la suite des recommandations explicites de la conférence de Brazzaville sur l’autonomie administrative. Aussi une loi, largement inspirée par Senghor, fut votée en août 1954; elle donnait la primauté au modèle européen tout en adoptant des correctifs tenant compte des réalités africaines ; la grande innovation est l’institution du collège unique. En adoptant la représentation proportionnelle avec scrutin de liste, l’autorité voulait associer à la gestion municipale les différents groupes ethniques, économiques et religieux; le sectionnement électoral restait cependant strictement géographique. Le Sénat, hostile à cette loi, refusait d’y inclure Madagascar (le souvenir du soulèvement de 1947 faisant encore peur) et voulait imposer le double collège en référence à l’Algérie. La loi fut promulguée en novembre 1955, au terme d’une bataille ardue. L’auteur y voit un acte essentiel de la décolonisation, avec la création de 44 communes de plein exercice qui furent de véritables arènes du débat politique.
L’exemple des émeutes de Brazzaville de février 1959 est révélateur des implications de la politique municipale, de l’agitation citadine et de la politique de décolonisation. A travers une analyse précise des archives de l’époque, C. Coquery-Vidrovitch propose une nouvelle interprétation d’un épisode tristement fameux de l’histoire de la décolonisation du Congo; ces émeutes nées du conflit entre Youlou et Opangault ont été hâtivement présentées comme une manifestation de l’exacerbation tribaliste. C. CoqueryVidrovitch y voit une manifestation essentiellement politique, fondée sur la manipulation consciente d’antagonismes culturels pour la conquête du pouvoir d’État; le cas de Brazzaville, cité éminemment tumultueuse, qui fut marquée quelques années plus tard par de nouvelles émeutes ayant débouché sur les « trois glorieuses » qui, en 1962, renversèrent Youlou, montre à quel point la ville africaine, de plus en plus, est le théâtre par excellence de la compétition souvent violente pour le pouvoir.
L’intérêt de l’article réside également dans la problématique novatrice centrée autour de la ville, et dans l’état des recherches en préparation à l’université de Paris-VII sur l’histoire de la gestion urbaine de la Seconde Guerre mondiale à la première décennie de l’indépendance.
L’histoire de l’État postcolonial en Afrique noire est marquée par la primauté de l’armée et par le cycle infernal des « prononciamientos » ; d’où l’intérêt de la communication de Myron Echenberg intitulée « Promotion africaine » : The Africanization of Military Officers and Decolonisation in French West Africa — 1945/1960. L’auteur fait remonter son étude à la période de la Seconde Guerre mondiale; les mutations dans le domaine politique et social obligèrent à réexaminer les problèmes militaires. Les tensions nées de la répression sanglante des soldats africains à Thiaroye en décembre 1944 imposaient des changements. Le débat porta sur les modalités d’une plus grande intégration des officiers noirs dans l’armée française; leur nombre, du reste, était fort limité jusqu’à la réforme de 1955-1956, car les officiers européens opposèrent une résistance à la politique d’assimilation préconisée par la conférence de Brazzaville. Myron Echenberg fait remarquer que la première brèche apparaît en 1954, en rapport avec l’insurrection déclenchée par le FLN en Algérie. L’armée française a besoin d’une complète révision de l’ image du Tirailleur sénégalais et chercha à attirer des jeunes Africains en formation dans les lycées. Une campagne de propagande fut organisée à cet effet, baptisée « Promotion africaine » ; des revues comme Soldat d’outre-mer et Frères d’armes tentaient d’atténuer sinon d’éliminer les barrières et les préjugés. La promotion en 1956 des commandants Soumaré et Fall participe de ce mouvement. Myron Echenberg examine alors les cinq voies susceptibles de conduire les jeunes cadets africains au grade d’officiers. Saint-Cyr et d’autres grandes écoles, où les éléments les plus brillants du niveau baccalauréat étaient orientés, les écoles d’application tels Saint-Maixent et Saumur plus accessibles et les écoles spécialement destinées aux Africains avec la mise en place du Programme Efortom qui fut la véritable pépinière d’officiers africains. Faisant une projection, M. Echenberg note avec pertinence que la liste des officiers formés à l’Efortom constitue un véritable Who’s Who des officiers ayant réussi ou aspiré à être présidents en Afrique noire francophone. De fait, conclut M. Echenberg, la minorité des officiers africains fut le véritable bénéficiaire des indépendances. Non seulement ils connurent une promotion rapide, mais encore, profitant des crises politiques, ils confisquèrent l’exercice du pouvoir. Un problème crucial de l’Afrique d’aujourd’hui, en rapport avec les aspirations à la démocratie, est celui de la place et du rôle de l’armée dans la nation.
Dans la marche à l’indépendance, il y eut certes des tensions et des conflits, mais ceux-ci restèrent localisés dans le temps et dans l’espace. La lutte armée, prônée par les éléments les plus radicaux, n’eut pas lieu dans les territoires d’Afrique noire francophone, à l’exception du Cameroun, où l’UPC déclencha un mouvement insurrectionnel. De nombreux facteurs ménagèrent des p uvertures, créèrent des ruptures de pente qui imprimèrent au processus de transfert du pouvoir un rythme modéré marqué par le compromis. Deux communications traitent de cet aspect: celle de Denise Bouche qui étudie le « passage de l’autorité de l’administration française au militant africain » et celle de Régine Goutalier qui traite de « la passation des pouvoirs dans la Communauté : 1958-1960 ». La problématique soulevée par D. Bouche est celle d’une situation instable des rapports de forces et des alliances entre administration, chefs traditionnels et partis modernes. Dans le cheminement de son analyse, D. Bouche évoluera du commandant de cercle, ce « roi de la brousse », au gouverneur général, véritable proconsul. Assisté d’une poignée de collaborateurs européens et de quelques fonctionnaires subalternes africains, ce « roi sans couronne» était puissant et craint, car le moindre signe d’irrespect, le moindre retard dans l’exécution des ordres tombaient sous le coup des peines spéciales de l’indigénat. Il n’était cependant pas à l’abri des manipulations de l’interprète qui, entre les chefs et l’administrateur, apparaît comme le véritable meneur du jeu, comme en témoigne le personnage décrit avec verve, mais non sans exactitude, dans l’Étrange Destin de Wangrin d’Amadou Hampaté Bâ. La tâche de ces administrateurs, souligne D. Bouche, ne fut certainement pas facile, et ils se trouvèrent souvent placés devant un dilemme. Ce fut notamment le cas, après 1945, lorsque le corps fut renouvelé par de jeunes administrateurs aux idées parfois libérales, sinon progressistes. Dans la compétition politique qui caractérise cette époque, l’administrateur et le chef traditionnel vont souvent se trouver en situation de conflit, l’enjeu donnant parfois lieu à un véritable imbroglio. D. Bouche cite en exemple le cas d’un chef agui qui, en 1952, plaça dans une situation fort embarrassante l’administrateur colonial. Le dilemme de ces jeunes administrateurs s’exprimait en ces termes: il était délicat de ne pas soutenir un chef qui se disait « ami de la France », mais il était exaspérant d’avoir à soutenir des gens accusés de despotisme et de malversations, surtout dans un contexte de dénigrement systématique de la chefferie: un cas typique est évoqué, celui du cercle de Bobo-Dioulasso, périodiquement agité entre 1915 et 1941, où les éléments du CEFA (Comité d’études franco-africaine) préconisaient l’opposition à l’autorité traditionnelle. A travers l’exemple de la Côte-d’Ivoire, D. Bouche nous permet de mieux comprendre les rapports complexes entre l’administration, le parti moderne et la chefferie traditionnelle. Le PDCI-RDA, organisé en parti de masse structuré et bénéficiant de l’appui d’éléments communistes, avait réussi, dès 1948, à instaurer une sorte de pouvoir parallèle; les incidents se multiplièrent, dégénérant parfois en de véritables expéditions, qui aboutirent, en 1950, aux incidents sanglants de Bouaflé, Dimbokro et Séguéla. L’appréciation du rapport des forces détermina le « repli stratégique », le désapparentement du RDA du parti communiste, acte que Houphouët-Boigny justifia par ({ la nécessité d’enlever aux réactionnaires le prétexte communiste et pour mettre les dirigeants français au pied du mur de l’Union française ». Quels furent les rapports entre le PD CI-RDA et la chefferie traditionnelle? D. Bouche énonce le principe qu’en 1945 pour un parti moderne à fins électoralistes il fallait soit gagner les chefs, soit les harceler, les déconsidérer et les réduire à la démission. Parallèlement, l’avenir des chefs dépendait en partie de leur intuition et de leur habileté à accompagner le courant; de ce double point de vue, la Côted’Ivoire a connu une évolution diamétralement opposée au cas de la Guinée évoqué par Jean Suret-Canale. C’est ainsi qu’en 1950 le chef supérieur des Sénoufos, alors âgé de quatre-vingt-dix ans, qui avait transigé successivement avec Samory, les colonnes françaises et l’administration coloniale, adhéra au PD CI-RDA, dans le souci de la paix et des intérêts de sa communauté. Houphouët- Boigny déclarera plus tard qu’il n’avait nulle intention de supprimer la chefferie; aussi pour la visite du général de Gaulle à Abidjan en août 1958 les convocations adressées aux chefs coutumiers furent acheminées par la section locale du parti et non par l’administration. D. Bouche évoque enfin la brève période au cours de laquelle les territoires passèrent de la loi-cadre au statut d’États autonomes, puis d’États souverains, période marquée par une floraison de partis, d’alliances et de ruptures. Selon la loi-cadre, le chef du territoire, président du conseil de gouvernement, était seul responsable du maintien de l’ordre. L’auteur insiste sur la difficulté de la tâche comme au Niger où deux partis différents par leurs bases se disputaient le pouvoir; plus encore en Guinée où le PDG-RDA détenait, dès 1956, les leviers de commande. D. Bouche souligne que le passage de l’autorité au niveau local a été le résultat d’une lutte d’influence quotidienne et multiforme. A l’échelle suprême, il n’y eut pas de coup d’éclat: lorsque, en décembre 1959, le haut commissariat de l’AOF fut supprimé, le dernier gouverneur général quitta Dakar avec les ‘honneurs, sur le Mermoz.
Si la communication de D. Bouche est basée sur une exploitation minutieuse des archives, celle de Régine Goutalier est fondée sur des enquêtes orales auprès des anciens administrateurs de la FOM. De ce point de vue aussi, les deux contributions se complètent pour éclairer la problématique de la passation des pouvoirs. Les témoignages sont tirés de trois mémoires, et l’auteur a délibérément pris le parti d’éviter toute interprétation ou critique, toute prise de position à l’égard des événements relatés. Les Mémoires de Louis Sanmarco, ancien gouverneur au Gabon et en Oubangui Chari, fournissent des données parfois insolites d’un réel intérêt pour l’historien, telle cette entente entre Léon Mba et Houphouët-Boigny qui aurait envisagé pour le Gabon le statut de département dans le cadre du référendum de 1958. En Oubangui-Chari, ce sont les rapports entre Sanmarco et Boganda qui sont évoqués. Personnage charismatique aux yeux des Oubanguiens, Boganda était, pour l’administration, un « redoutable agitateur démagogue, fils de sorcier et abbé défroqué ». Entre Sanmarco et Boganda s’amorcent des liens, une entente pour lutter contre le monopole sclérosant des compagnies cotonnières. Ils oeuvreront à modérer les tensions entre Blancs et Noirs au lendemain de la loi-cadre, mais se heurtèrent au manoeuvres du colonat. Les états d’âme de Boganda concernant l’alternative du référendum sont riches d’enseignements: pourquoi, se demanda-t-il, ne serait-il pas français si, suivant ses convictions de vieux républicain, il vote contre cette Constitution alors qu’un vieux républicain de la Lozère restera français s’il fait de même ? La seconde expérience évoquée est celle de Maurice Meker, chef de territoire de la Somalie, dans ses rapports avec Mahmoud Harbi, vice-président du conseil du gouvernement. Invité par Nasser à la première conférence afro-asiatique de 1957, impressionné par les positions de Sékou Touré, Mahmoud Harbi opta pour le « non » au référendum. Le chef du territoire, conscient de l’enjeu et de la position géostratégique de la région, manoeuvrera, fera jouer contre Mahmoud la rivalité entre Somalis et Mars et parviendra à faire voter « oui» à 75 %, succès qui lui vaudra les félicitations personnelles du général de Gaulle. Le dernier témoignage est celui de Jean Clauzel, en poste à Goundam (au Soudan) de 1946 à 1950: c’est l’histoire d’un administrateur relégué à la périphérie, loin de l’ébullition politique animée par l’Union soudanaise RDA ; l’homme est passionné par tous les aspects socio-économiques de la région; il participe à la « conférence» de l’Azalay et visite les salines de Taoudeni. Mais il a mal ressenti l’évolution politique du pays et la marche à l’indépendance; aussi préfère-t-il passer le service à son successeur, en décembre 1958, au moment où la France allait se désengager. Régine Goutalier, à travers ces épisodes, ces faits, cette histoire au quotidien, montre combien les récits de vie sont riches d’enseignements, en dépit de leur caractère subjectif et limité.
Telle est la substance de ces onze premières communications, qui toures donnent un éclairage sur le rôle des forces internes dans la marche à l’indépendance ; l’impression qui se dégage, surtout au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, est celle d’une vie politique et sociale dynamique faite de courants et de tendances variés, ce qui rend caduque et sans fondement la thèse parfois développée d’une indépendance octroyée. L’indépendance a été le résultat d’une longue marche, d’un processus complexe, parfois ambigu (pour reprendre la formule chère à G.W. Johnson). Certes, le facteur métropolitain et l’environnement international ont largement contribué au mouvement d’émancipation, mais la dynamique interne, les aspirations et les luttes des peuples africains ont été décisives dans ce processus. Ces forces internes, libérées des pesanteurs de l’État postcolonial, sont certainement susceptibles d’un sursaut pour créer, trente ans après la cascade des indépendances, une dynamique nouvelle afin de relever les défis d’aujourd’hui.
Thierno M. Bah
Université de Yaoundé
No Comments
Sorry, the comment form is closed at this time.
